
Plan IDF sans sida
La Région Île-de-France, région la plus touchée par le VIH/sida en France, s'est dotée d'un plan visant à mettre fin à l'épidémie sur le territoire d'ici 2030. Le Crips Île-de-France tient un rôle central dans la mise en œuvre de ce plan « Pour une Île-de-France sans sida ».
-
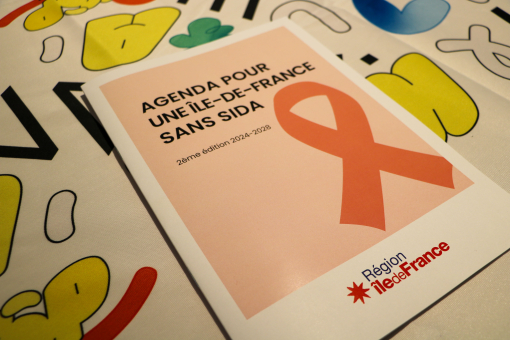 Agenda 2024-2028
Agenda 2024-2028Présentation de l'agenda pour une Île-de-France sans sida : 2ème édition 2024-2028. Le 29 mai 2024, afin de consolider son engagement et lancer une nouvelle phase de mobilisation pour mettre un terme à l'épidémie, le Conseil régional a voté le second volet de son "Agenda pour une Île-de-France sans sida".
Copyright de la vignette: Crips Île-de-France



