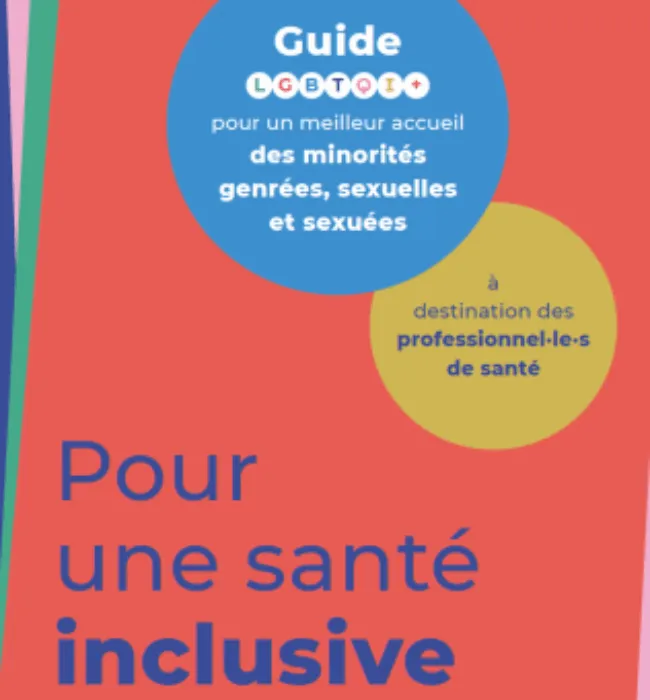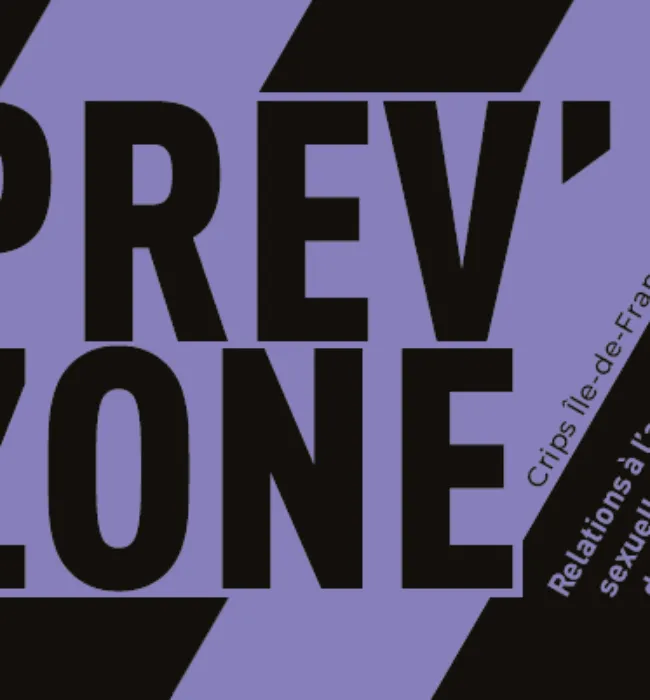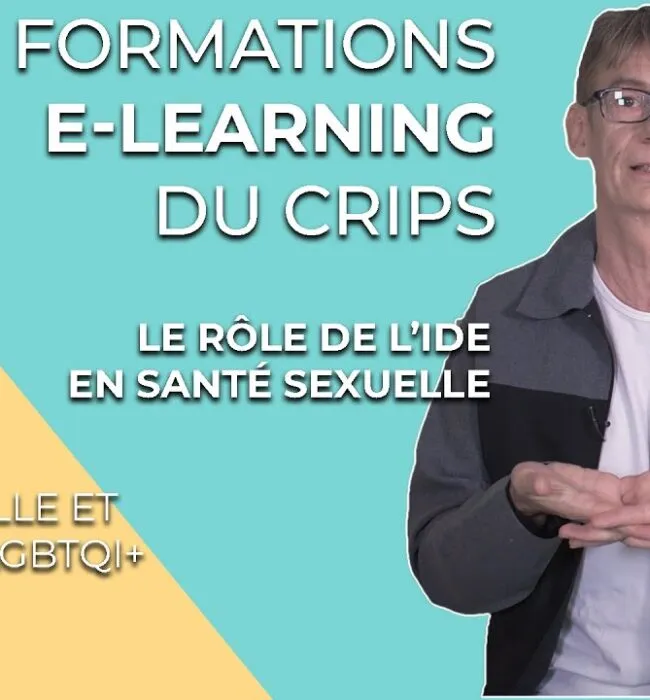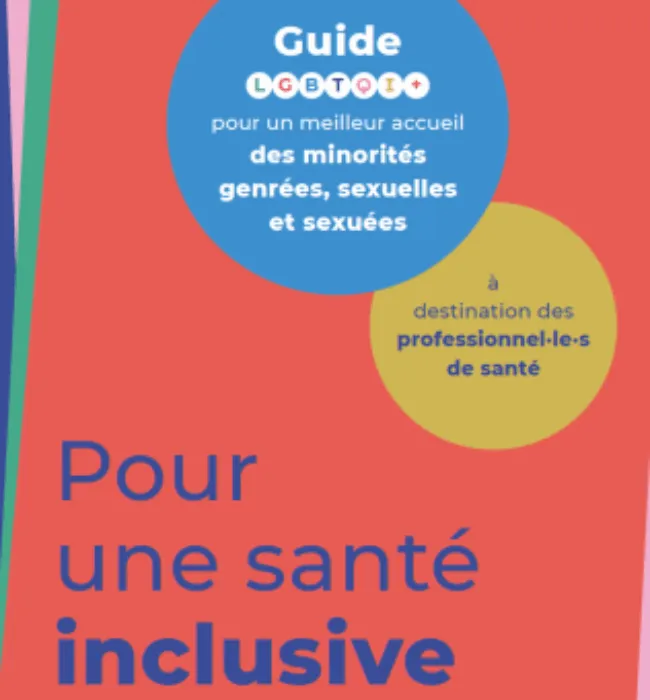
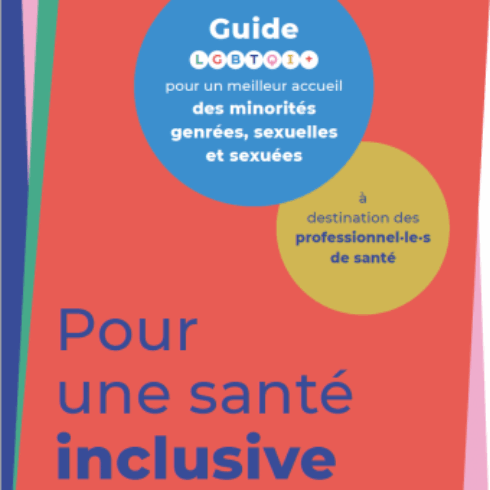
Guide LGBTQI+ pour un meilleur accueil des minorités genrées, sexuelles et sexuées à destination des pros de santé
Crée le 11 octobre 2025, modifié le 21 octobre 2025
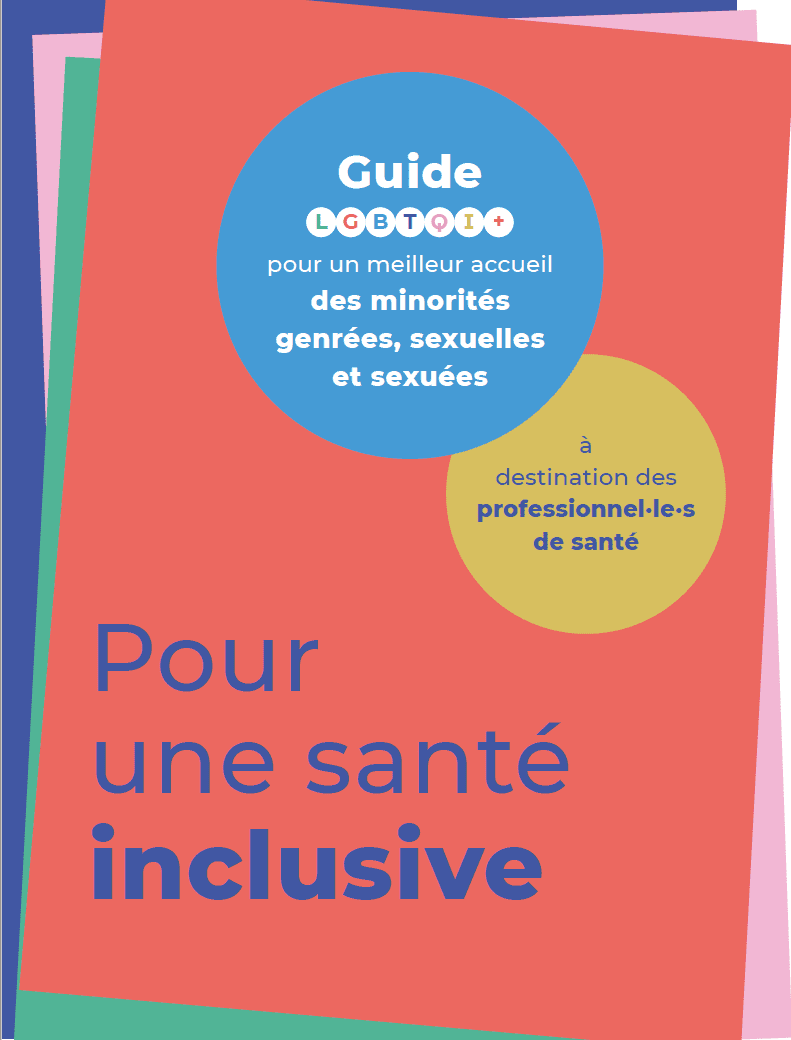
- 57,5 % des femmes lesbiennes ont peur d’être discriminées ou jugées en annonçant leur sexualité.
- Chez les personnes trans, une étude suggère que le risque de tentative de suicide avant 25 ans serait de 50 % environ dans diverses régions du monde.
- En 2020, 62 % des répondant·e·s intersexes participant à l’enquête européenne de la FRA-UE annoncent avoir subi des interventions chirurgicales modifiant leurs caractéristiques sexuelles sans avoir pu donner leur consentement.
- Les femmes trans sont 49 fois plus susceptibles d’être séropositives pour le VIH.
- 14,3 % des personnes HSH préfèrent éviter les soins, suite à des discriminations subies.
- 34,7 % des personnes ayant fait leur « coming out médical » se sont senties jugées par leur médecin.
Comment l’imbrication de ces discriminations peut-elle impacter la qualité et l’accès aux soins des individus ?
Les discriminations, vécues ou entendues, peuvent être intériorisées par les personnes et déclencher différents comportements : angoisse par rapport au monde médical, peur du jugement, anticipation d’une mauvaise prise en charge, perte de confiance, stratégies d’évitement des professionnel·le·s de santé…
« J’avais 16 ans et je ne savais pas encore que j’étais une personne trans, […] j’étais en couple avec une fille. Je ne savais pas si on pouvait contracter des MST […]. Je suis allé chez la gynécologue de ma mère […], et elle s’est moquée de moi en disant que non, nous ne pouvions pas avoir de MST parce que nous ne faisions pas du vrai sexe […]. Cette expérience m’a dissuadé d’aller voir un·e gynécologue pendant longtemps, au détriment de ma santé. »
Il est important d’avoir conscience de ces discriminations et de leur impact sur les comportements des patient·e·s afin d’adapter sa prise en charge. C’est un réel enjeu de santé publique !
Comment être plus inclusif·ve ?
L’inclusivité, qu’est-ce que c’est ?
L’inclusivité est une ouverture et une bienveillance envers tou·te·s. Chacun·e a une compréhension du monde issue de son éducation, de sa culture, de son genre et/ou de ses expériences de discriminations. Prendre conscience du fait que l’on peut projeter ses représentations sur les patient·e·s est un premier pas vers une prise en charge plus adaptée. Il est toujours possible de s’améliorer et de s’outiller pour créer une approche inclusive du soin, un espace accueillant pour tou·te·s ! Lorsqu’on travaille avec des minorités genrées, sexuelles et sexuées, deux principaux phénomènes sociaux sont à détricoter : l’hétéronormativité et la cisnormativité. Même si ces mots peuvent faire peur, les réalités qu’ils recouvrent méritent d’être questionnées
Qu’est-ce que l’hétéronormativité ?
C’est le fait que l’hétérosexualité soit perçue comme évidente, naturelle et allant de soi pour tou·te·s. C’est une norme sociale qui détermine la manière dont on perçoit le monde. Si on ne la questionne pas, on risque de venir renforcer les sanctions sociales (rejet familial, harcèlement scolaire, violences…) que subissent celles et ceux qui s’en éloignent. Une femme arrive pour une consultation gynécologique…
Attention à ne pas présupposer :
- De l’orientation sexuelle de la personne et de ses pratiques.
- Du nombre et de l’identité de genre de son·sa ou ses partenaires sexuel·le·s.
- Du fait que la personne utilise ou veut forcément une contraception.
Conseils : au début de la consultation, n’hésitez pas à poser des questions ouvertes : « Avez-vous un, une, des partenaires sexuel·le·s ? », « Avez-vous besoin d’une contraception ? »
Qu’est-ce que la cisnormativité ?
La norme sociale est aussi cisgenre, c’est-à-dire qu’elle privilégie et normalise les personnes dont le sexe assigné à la naissance correspond au genre de la personne. La cisnormativité renvoie les personnes trans, non-binaires et intersexes à une forme de pathologisation et de marginalisation sociale. Une femme arrive pour demander la PrEP et tend sa carte Vitale qui affiche un prénom masculin et le numéro 1. Attention à ne pas présupposer :
- Du genre de la personne.
- Du parcours de transition médical, social, administratif de la personne (chaque parcours est unique).
- De l’orientation sexuelle et/ou des pratiques sexuelles de la personne.
Conseils
- Éviter les remarques sur le physique, même positives, s’il n’y a pas de lien avec la consultation.
- Si vous avez un doute la première fois, demandez quels prénoms et pronoms la personne utilise. Si vous faites une erreur, n’hésitez pas à vous excuser.
Quelques idées pour créer un espace inclusif —
- Toilettes non genrées (par exemple mettre juste « toilettes »).
- Affiches et magazines inclusif·ve·s.
- Brochures inclusives à disposition.

Bon à savoir ! Le Crips oriente et conseille les acteur·rice·s de la prévention à la recherche d’outils pédagogiques, de connaissances, ou de méthodes pour aborder les thématiques de santé de la manière la plus adaptée à leur public. Vous pouvez adresser vos demandes par mail à infopros@lecrips.net ou par téléphone au 01 84 03 96 95.
Qu’est-ce que ça apporte ?
- Un sentiment de sécurité et de confiance pour le·la patient·e et pour vous.
- Une alliance thérapeutique.
- Une meilleure connaissance des patient·e·s.
- Un meilleur suivi médical.

Lorsqu’on fait preuve de bienveillance
« Si je sens que le·la praticien·ne est bienveillant·e ou à l’écoute lors de la première rencontre, il sera assez évident de faire part de mon orientation sexuelle sans que cela ne soit un sujet en soi. »
Lorsqu’on fait preuve d’écoute
« Une psychothérapeute qui n’a pas remis mon identité de genre et mon orientation en question une seule fois et qui a été très à l’écoute de mon ressenti. Elle a fait preuve d’écoute et d’empathie et c’est toujours bien de se sentir au moins écouté.e , si ce n’est compris·e. »
Lorsqu’on pose des questions pertinentes et non-intrusives
Je me sens moins en confiance lorsqu’on « me pose des questions trop intimes sur mes pratiques [et lorsqu’on] me fait des remarques qui ne sont pas en rapport avec ce pour quoi je viens. »
Lorsqu’on a connaissance des spécificités du sujet
« Je ne m’annonce non-binaire qu’en présence de gens qui peuvent comprendre. »
Quelques recommandations
Comme de nombreuses populations fortement stigmatisées dans l’ensemble de la société, la place de ce qui est « pathologisé » prend souvent une place envahissante au moment de la consultation, et peut masquer les conséquences des discriminations, ou tout autre symptôme commun.
Évitez les questions sans rapport avec l’objet de la consultation sur les opérations chirurgicales de réassignation génitale, qui peuvent être perçues comme invasives.
Veillez à ne pas demander que le ou la patient·e se déshabille, alors qu’un examen n’est pas nécessaire.
Pour faciliter la relation, il peut être important de travailler sur les préjugés liés à des représentations sociales pouvant être très marquées, tels que ceux liant les femmes trans au travail du sexe, qui peuvent induire un jugement moral et désengager le·la professionnel·le au moment de la consultation.
II est important de prendre en compte la récurrence des vécus de violences médicales dans la relation soignant·e/ patient·e, et de porter une attention particulière à la mise en place d’un environnement de confiance avec les personnes.
Se former et s’informer

- Une entrée dans la vie sexuelle plus précoce, notamment avec des partenaires masculins.
- Des pratiques sexuelles plus diversifiées, la pratique la plus souvent déclarée étant la pénétration vaginale (98 % selon l’Enquête Presse Gays et Lesbiennes 2011 ; 97 % selon SexoFSF 2017).
- Un nombre de partenaires plus élevé que chez les femmes se déclarant hétérosexuelles, ce, majoritairement avec des hommes. 72 % déclarent plus de 3 partenaires dans les 12 derniers mois et une médiane de 9 partenaires vie (SexoFSF 2017).
- Des expériences de violences plus courantes, notamment en lien avec leur orientation sexuelle. Plus de 60 % des femmes disent avoir vécu au moins un épisode de violence lesbophobe dans leur vie. Elles sont également 20 % à déclarer avoir déjà vécu des commentaires lesbophobes, rejets ou refus de soins dans l’espace médical. Selon la National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS) de 2010, 1 femme homosexuelle sur 3 aurait connu au moins une forme de violence physique sévère de la part d’un·e partenaire intime (contre 1 femme hétérosexuelle sur 4).
- Une exposition plus forte au risque dépressif : les femmes lesbiennes et/ou bi vivent un stress quotidien lié au fait d’appartenir à une minorité encore fortement stigmatisée et soumise à des discriminations sociales et institutionnelles qui peuvent avoir un impact en terme de santé (anxiété, troubles dépressifs, idéations suicidaires, usages de produits, prévalence élevée d’IST…). L’Enquête sur la sexualité en France dite « Contexte de la sexualité en France » (CSF) rapporte que, parmi les 18-24 ans, 89,2 % des femmes homo/bisexuelles déclarent avoir été déprimées au cours des 12 derniers mois.
6. Une prévalence d’IST élevée : toujours dans la CSF, elles sont 12 % (versus 3 % des femmes hétérosexuelles) à rapporter avoir eu une infection sexuellement transmissible dans les 5 dernières années.
7. Un moindre recours aux soins et au dépistage : dans l’EPGL 2011, les répondantes n’ayant que des rapports sexuels avec des femmes au cours de leur vie sont 36 % à n’avoir jamais eu recours à une consultation gynécologique, 60 % à n’avoir jamais réalisé de frottis cervicoutérin, 58 % à n’avoir jamais réalisé de test VIH et 90 % à n’avoir jamais réalisé de test chlamydiae. Ce défaut de recours aux soins peut avoir des conséquences graves sur la fertilité et la santé des femmes avec une augmentation des cancers du col de l’utérus et des seins.
Quelques recommandations
Veiller à ne pas présumer des pratiques sexuelles des personnes : il est encore parfois difficile de se représenter une sexualité active et pénétrante en dehors du principe masculin et du pénis. Cette représentation conduit beaucoup de femmes à développer un sentiment d’immunité au VIH et aux IST qui est partagé par les soignant·e·s.
L’auto-identification des personnes en tant que lesbiennes ne signifie pas qu’elles n’ont pas de rapport sexuel avec des hommes.
Veiller à ne pas présenter la contraception comme « évidente ». La contraception présentée comme obligatoire peut être vécue comme une assignation à l’hétérosexualité et empêcher la parole des patientes.
Être à l’écoute d’un potentiel désir d’enfants émis par les patientes.
Se former et s’informer
Accueillir les personnes HSH
Données clés en santé
Les HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes) ont 200 fois plus de risques de contamination au VIH que la population hétérosexuelle française. Entre 2013 et 2018, ce sont 40,8 % des découvertes de séropositivité qui concernent les HSH. Ils représentent 58 % des découvertes de séropositivité à Paris contre 41 % en Île-de-France. S’agissant des autres IST, en 2019, les HSH représentent 79 % des nouveaux diagnostics pour une syphilis récente et 74 % des diagnostics pour une gonorrhée, soit une augmentation de 29 % par rapport à 2017. La prévalence de l’infection anale au HPV chez les HSH est de 64 % (contre 25 % chez les hommes hétérosexuels). Elle est encore plus élevée chez les HSH vivant avec le VIH : 93 %. Les HSH ont 20 fois plus risque de développer un cancer anal.
Prévention des risques VIH : la prévention du VIH s’est diversifiée, ces dernières années, avec trois nouveaux outils incontournables et combinables : la PrEP, le TasP et le TPE.
La PrEP (Prophylaxie préexposition) : un traitement préventif, pris ponctuellement ou quotidiennement, qui permet de rester protégé du VIH.
Le TasP (Treatment As Prevention) : une personne séropositive traitée avec une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le virus.
Le TPE (Traitement postexposition) : une trithérapie de 28 jours qui réduit considérablement les risques d’une séroconversion, si le traitement est pris au plus vite et dans un délai maximal de 48 heures après le rapport non protégé. Il peut être demandé à l’hôpital ou en CeGIDD.
Ces outils sont complémentaires et permettent à chaque patient·e·s d’opter pour une protection idéale. L’utilisation de cette prévention personnalisée a permis en 2018, chez les HSH une diminution de la transmission du VIH de 22 % en moyenne, et de 28 % chez les HSH nés en France. L’expérience montre qu’il ne sert à rien de forcer l’usage du préservatif chez quelqu’un qui ne l’utilise pas régulièrement. Ici aussi, une sensation de jugement peut détourner du soin et il peut être intéressant de questionner le ressenti des personnes sur la qualité de leur sexualité. Dans ce cas, la PrEP est souvent une bonne alternative et la prévention IST passe principalement par le dépistage très régulier (tous les 3 mois).
Qu’est-ce que le Chemsex ?
Le Chemsex est l’usage de substances psychoactives dans un cadre sexuel. Fréquemment en multipartenariat avec des pratiques dites « hard » comme le fist-fucking. Ces moments peuvent durer des heures, voire des jours. Les participant·e·s n’appliquent pas forcément les mesures de prévention sexuelle ou de réduction des risques (RdR) pour la consommation de substances psychoactives (SPA), que ce soit par manque d’informations, contexte ou effets des produits. Au Checkpoint, 35 % de la patientèle pratiquent le Chemsex. Au-delà des contaminations par le VIH, le VHC, le VHB ou d’autres IST, il ne faut pas oublier de potentielles problématiques liées à la consommation de SPA (addictions, état veineux…).
Recommandations
- Être vigilant·e sur les troubles dépressifs et risques suicidaires. Chez les hommes gays/bisexuels, 1/3 des moins de 20 ans ont déclaré au moins une tentative de suicide au cours de leur vie.
- Veiller à ne pas présupposer que tous les HSH ont les mêmes pratiques, pénétration orale, anale, anulingus (être vigilant·e quant à ses propres préjugés).
- La vaccination gratuite contre le HPV pour les HSH jusqu’à 26 ans est recommandée, depuis 2016, par le Haut Conseil de la santé publique.
- La vaccination contre l’hépatite A est fortement recommandée puisque le mode de contamination principal est oro-fécal (ex : anulingus).
- La vaccination contre l’hépatite B pour les personnes qui ont des relations sexuelles avec des partenaires multiples est recommandée.
Quelques exemples pour vous guider dans votre prise en charge
Un patient qui a principalement des rapports non protégés. On lui exposera les différentes méthodes de protection et on lui indiquera qu’il est libre de choisir celle qui lui convient.
- « Avez-vous eu des rapports sexuels avec des hommes et/ou des femmes ? »
- « Y a-t-il eu pénétration anale ou orale non protégée ? »
- « Avez-vous pratiqué des anulingus ? »
- « Consommez-vous des produits psychoactifs ? »
Se former et s’informer
En cas de violences sexuelles
Orienter
Les centres psychotrauma.
Accueillir les jeunes des minorités genrées, sexuelles et sexuées
L’accompagnement des jeunes des minorités genrées, sexuelles et sexuées s’avère différent de celui de leurs aîné·e·s, d’où l’importance de les rediriger vers les associations adaptées qui peuvent les soutenir et les accueillir avec bienveillance.
Données clés en santé
- Les jeunes hommes homosexuels se font moins dépister que leurs aînés (63,8 % des moins de 25 ans contre 83 à 92 % des plus de 25 ans). Or ils ont plus de risques d’être exposés aux IST.
- D’un point de vue de la santé mentale, il y a plus de risque de suicide chez les jeunes des minorités genrées, sexuelles et sexuées que chez les personnes hétérosexuel·le·s et/ou cisgenres.
- Il y a une surexposition aux violences intrafamiliales des personnes homosexuel·le·s et bisexuel·le·s, par rapport aux personnes hétérosexuel·le·s.
- Selon une étude du MAG Jeunes LGBT, 52,17 % des jeunes LGBT+ ont subi des violences scolaires.
L’adolescence étant un moment de questionnement pour tous les jeunes, il est important d’apporter une attention particulière à l’écoute des jeunes des minorités genrées, sexuelles et sexuées.
Recommandations
Êtes-vous en droit de prévenir les parents si la personne est mineure ?
Non, vous ne devez pas prévenir les parents s’il s’agit d’une simple consultation. Tant qu’il n’y a pas d’intervention pratiquée ou de thérapeutique engagée. Le·la mineur·e a également le droit d’interdire à ses parents l’accès à son dossier médical ou même à son état de santé (loi du 4 mars 2002).
Comment assurer une meilleure confidentialité ?
Lorsqu’un·e mineur·e de moins de 16 ans vient consulter, il est préférable de le·la rediriger vers des institutions dans lesquelles il·elle n’aura pas à payer (hôpital, planning familial), pour éviter qu’il·elle utilise la carte Vitale de ses parents. Certain·e·s professionel·le·s de santé peuvent choisir de ne pas faire payer la consultation.
Et le dépistage ?
N’hésitez pas à aborder la question du dépistage comme outil de prévention. Vous pouvez recommander aux jeunes de garder un bon réflexe et de se faire dépister régulièrement, au moins tous les 3 mois s’ils ont une vie sexuelle active, sinon une fois par an au minimum.
Vers qui rediriger ?