
Consentement
Accès membres

Crée le 23 septembre 2025, modifié le 29 novembre 2025
Le chemsex est un phénomène en forte progression, qui associe usage de substances psychoactives et sexualité, principalement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) mais également dans d’autres groupes.
Les professionnels ont un rôle essentiel afin de soutenir les parcours en santé et favoriser l’accès aux ressources de prévention.
Le chemsex est issu de la contraction de « chemical » et « sex ». Il désigne l’usage intentionnel de substances psychoactives dans un contexte sexuel, principalement chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais aussi dans d’autres groupes.
Le chemsex est apparu dans les années 2000 au Royaume-Uni, puis s’est diffusé en Europe, notamment dans les grandes métropoles françaises.
Cette pratique est favorisée par l’essor des applications de rencontre et l’accès facilité aux substances psychoactives.
Les substances les plus fréquemment utilisées sont :
Les modes d’administration sont variés : ingestion, sniff, injection (slam), plug (voie rectale).
Le chemsex est très majoritairement observé chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH). Selon l’enquête européenne EMIS de 2017, 12,5% des HSH en France et 10,8% en Europe déclaraient avoir pratiqué le chemsex au cours des douze derniers mois.
Si les HSH restent le principal groupe concerné, plusieurs études récentes montrent que d’autres publics, notamment certaines personnes hétérosexuelles, sont également impliquées dans ces pratiques, bien que de manière moins fréquente. Cette évolution souligne une dynamique de diffusion du chemsex au-delà des groupes initialement identifiés.
Les données issues du dispositif TREND de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) révèlent par ailleurs une grande hétérogénéité des profils socio-démographiques. On retrouve des personnes pratiquant le chemsex dans toutes les tranches d’âge, au sein de différentes catégories socioprofessionnelles ou socio-économiques variées.
Le phénomène du chemsex ne touche pas un public homogène : il s’inscrit dans une diversité de parcours marqués par des discriminations croisées et des vulnérabilités spécifiques. Une approche intersectionnelle est indispensable pour comprendre et accompagner les personnes concernées.
Certaines personnes migrantes ou racisées peuvent pratiquer le chemsex dans des contextes de précarité, d’isolement social ou de stigmatisation. L’accès aux soins est souvent freiné par des barrières linguistiques, une méfiance vis-à-vis des institutions ou la peur d’être discriminé. Ces freins se retrouvent aussi chez d’autres populations.
Les personnes trans et non-binaires, encore peu visibles dans les études, sont également concernées. Le chemsex peut être un moyen d’échapper à des violences structurelles. Ces personnes rencontrent fréquemment des difficultés à accéder à des structures inclusives ou à des professionnels formés à leurs réalités.
Enfin, les personnes en situation de handicap ou les jeunes LGBTQIA+ en errance peuvent se retrouver dans des contextes de très forte vulnérabilité. Le chemsex peut apparaître comme un accès à la sexualité ou une forme d’inclusion, mais il s’accompagne de risques accrus et d’un manque d’offre adaptée.
Ces réalités soulignent l’importance de dispositifs de prévention et d’accompagnement accessibles, inclusifs et multiculturels.
Le chemsex expose à des risques sanitaires, tant infectieux que psychologiques et sociaux : transmission du VIH, des hépatites et d’autres IST, surdosages, dépendances, troubles psychiatriques et violences. Il y a donc des besoins spécifiques de prise en charge et de prévention à prendre en compte pour limiter les conséquences sur la santé individuelle et collective.
La pratique du chemsex est associée à une augmentation des risques infectieux :
Aux risques infectieux se cumulent les risques liés à la consommation de substances :
La pratique du chemsex résulte d’un ensemble de facteurs individuels, relationnels et sociaux. Les comprendre est essentiel pour adapter la prévention et l’accompagnement.
Les motivations internes incluent la recherche d’une performance sexuelle accrue, de sensations plus intenses ou prolongées, et la désinhibition permise par les substances (méthamphétamine, GHB, cathinones). Beaucoup de chemsexeurs évoquent aussi le besoin de surmonter des blocages, d’explorer des pratiques taboues ou de renforcer la connexion émotionnelle avec leurs partenaires. Le chemsex peut également servir à gérer la solitude, l’anxiété ou des discriminations, et parfois répondre à une dépendance qui s’installe progressivement.
Parmi les facteurs externes, on retrouve la pression des normes notamment liée à la performance, l’influence des partenaires et la recherche d’intégration à un groupe. Les applications de rencontre et les réseaux sociaux facilitent l’accès aux substances et la normalisation du chemsex, surtout chez les jeunes adultes. D’autres éléments favorisent l’entrée ou le maintien dans le chemsex comme une faible estime de soi ou l’impact du stress minoritaire.
Cette grande diversité de facteurs souligne l’importance d’une approche individualisée dans la prévention et l’accompagnement.
La prévention et la réduction des risques constituent des axes majeurs pour limiter l’impact du chemsex : information, accès au matériel de réduction des risques, dépistage, accompagnement et actions communautaires. Il est essentiel que l’approche des professionnels soit bienveillante, non jugeante et pluridisciplinaire, afin de favoriser l’accès aux ressources et soutenir les parcours en santé.
L’accompagnement des usagers du chemsex doit être multidimensionnel. Cette formation propose aux professionnels un socle de connaissances relatives à cette pratique ainsi qu’un travail concret pour mener un entretien individuel, ou mettre en place un projet d’intervention.
L’accompagnement et la prise en charge des personnes pratiquant le chemsex nécessitent une approche globale, pluridisciplinaire et adaptée à la diversité des situations. Les expériences de terrain, et les recommandations notamment de la Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques (MMPCR) convergent vers la nécessité de dispositifs coordonnés, accessibles et non jugeants.
Les associations ont éditées de nombreux outils d’information parmi lesquels :
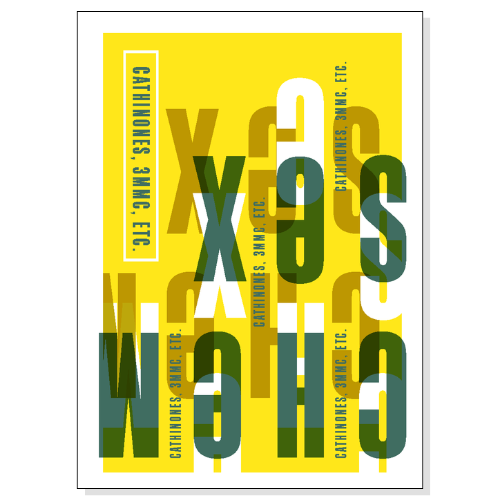
Les brochures « produits psychoactifs »
éditées par AIDES. Cathinones, 3MMC, GHB/GBL, méthamphétamine, etc…
Elles sont disponibles gratuitement sur le site d’Aides
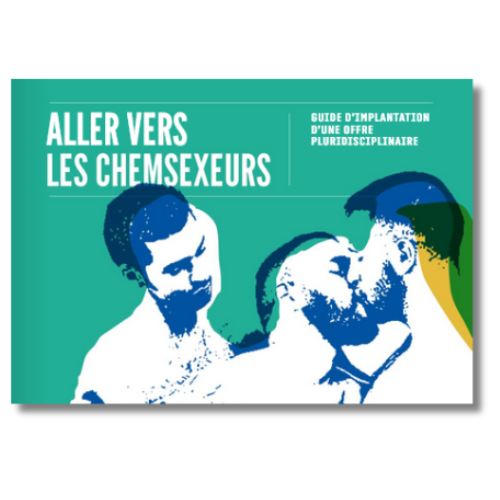
Pour l’accompagnement pluridisciplinaire, édité par AIDES et la Fédération Addiction.
A découvrir sur le site d’AIDES.
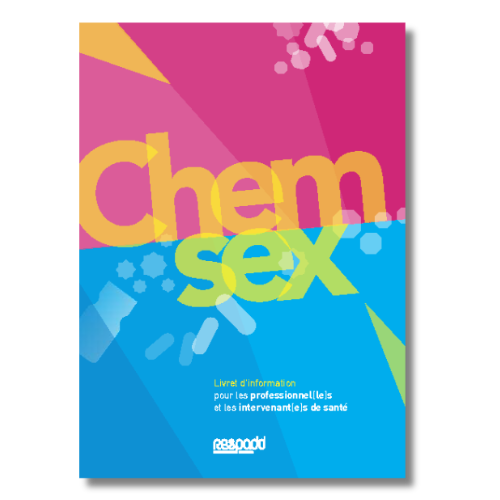
Livret Chemsex du RESPADD
Livret Chemsex du RESPADD, qui détaille les pratiques à risque, le matériel disponible et les démarches de prévention, dépistage et orientation.
Un livret disponible gratuitement sur le site du RESPADD.
IDES propose un dispositif national d’écoute et de soutien. Les volontaires de AIDES, formés aux usages en contexte sexuel et à la réduction des risques, assurent l’écoute, l’orientation et la confidentialité, tout en garantissant le non-jugement des pratiques.
Deux documents pour approfondir l’état des lieux et de la recherche :

Accès membres
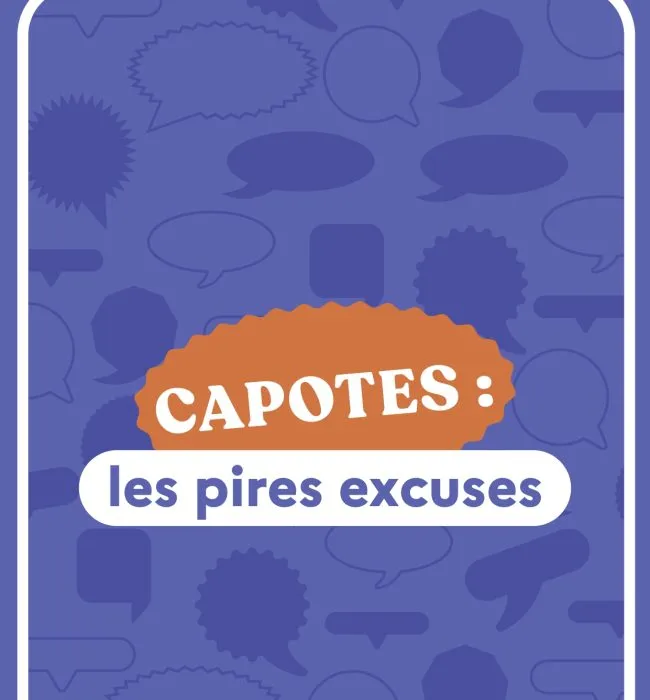
Accès membres
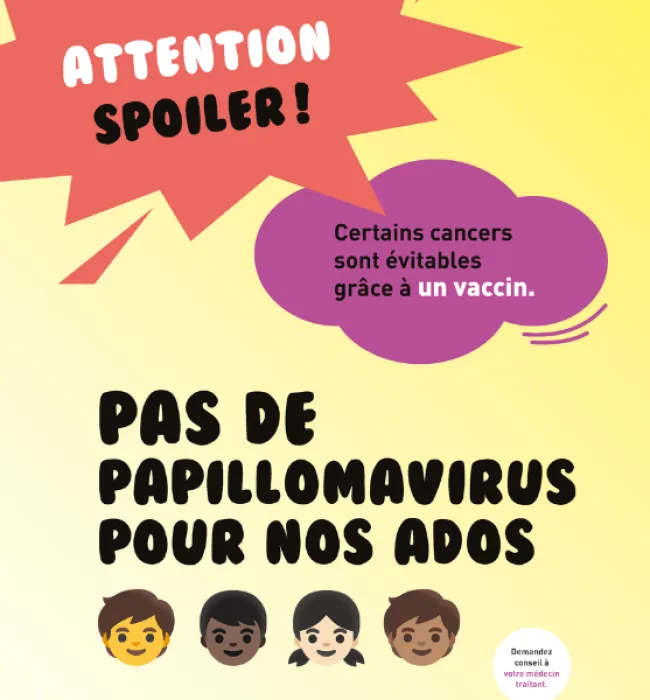

Accès membres
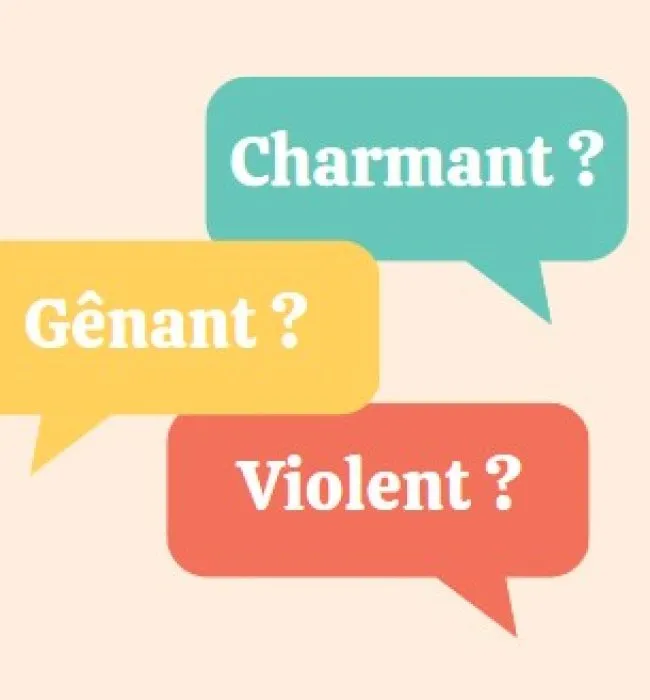
Accès membres

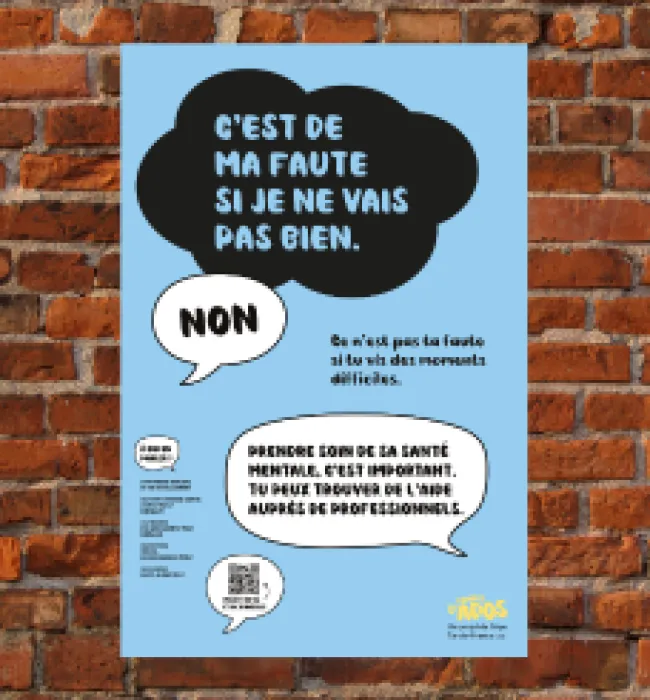

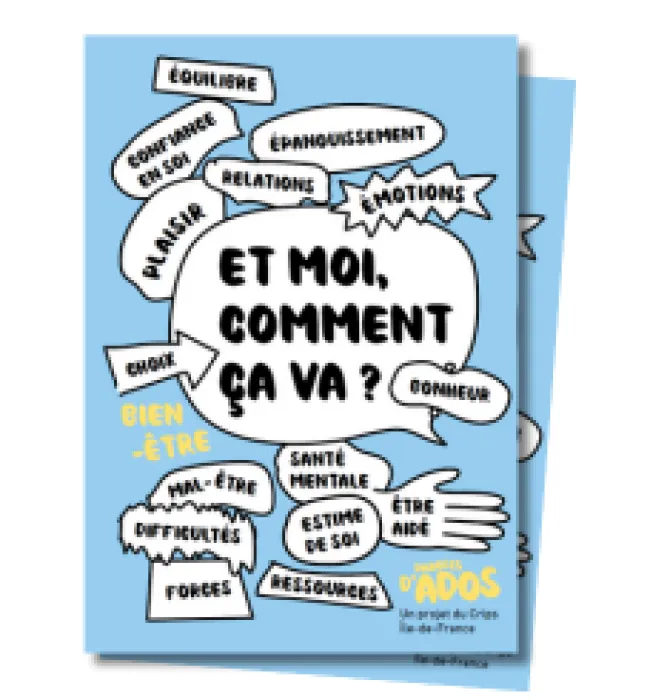
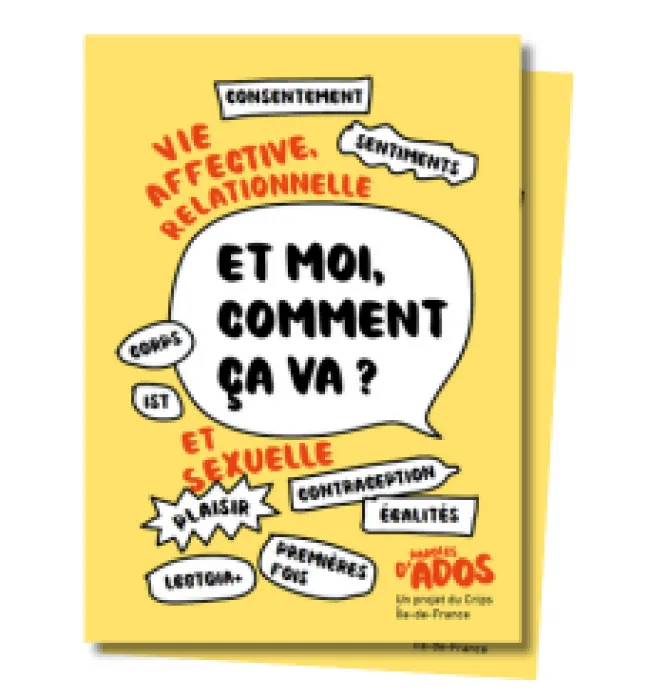

Accès membres
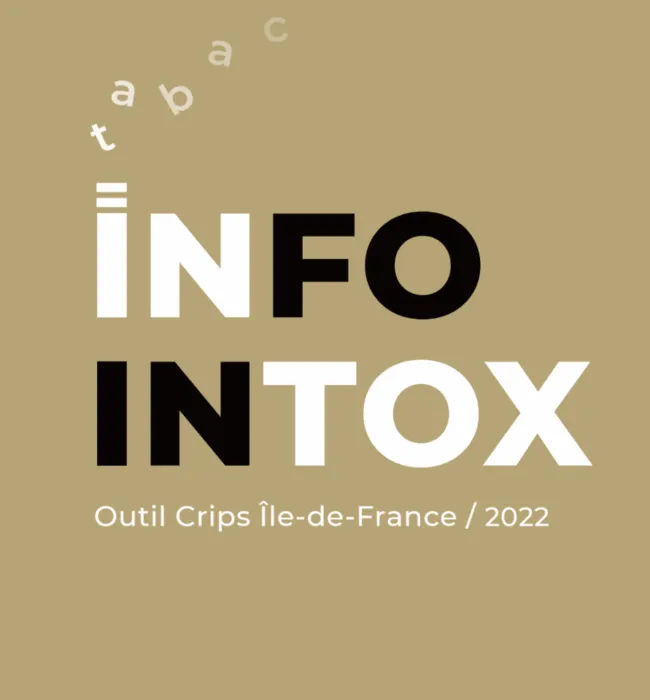
Accès membres

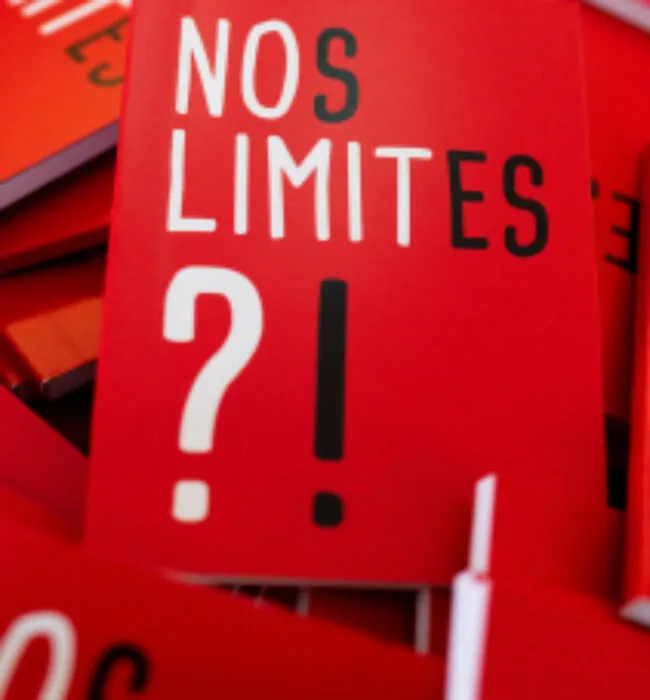

Accès membres
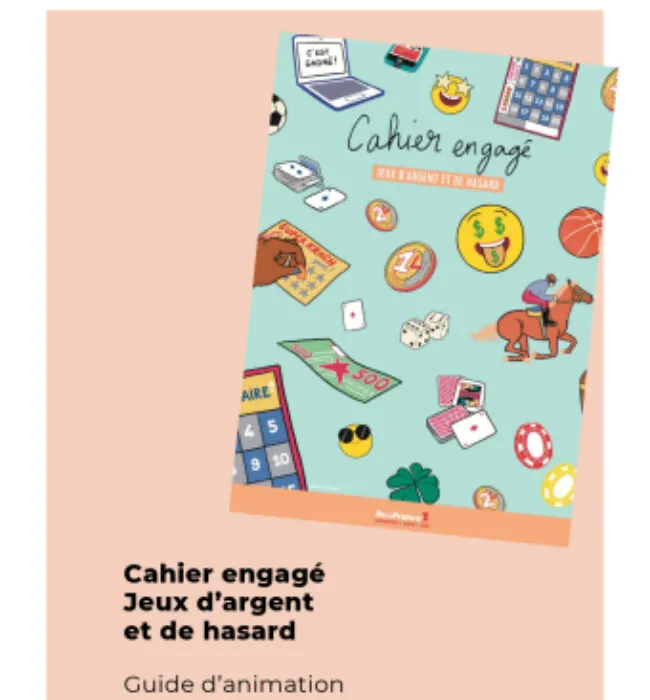
Accès membres
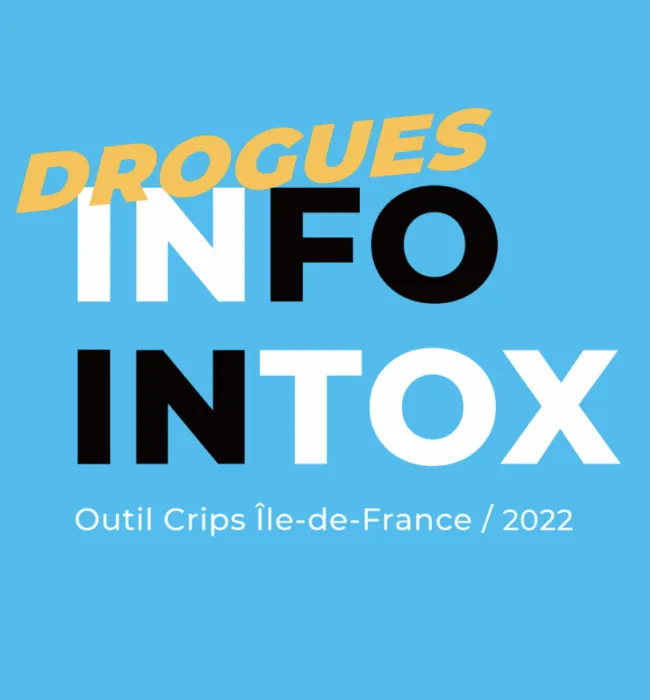
Accès membres
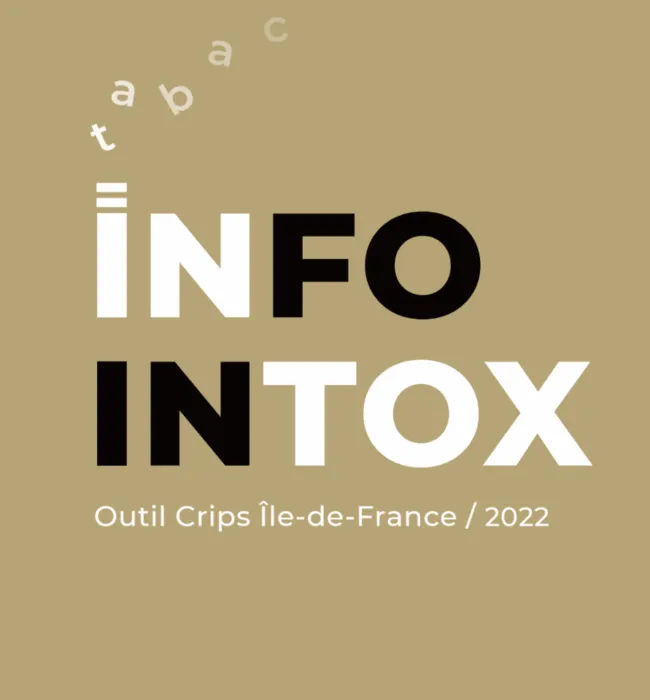
Accès membres

Accès membres
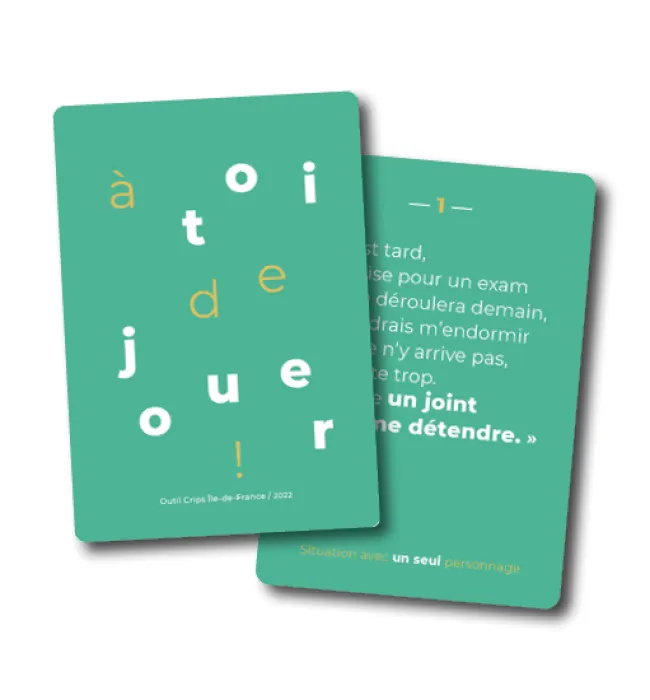
Accès membres